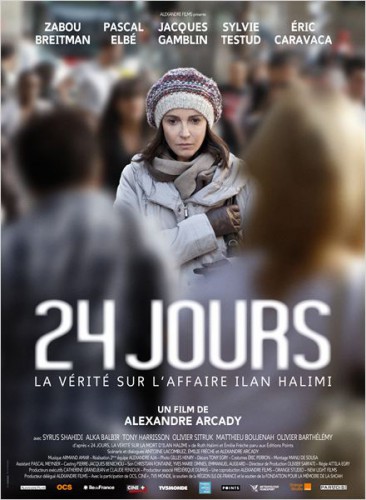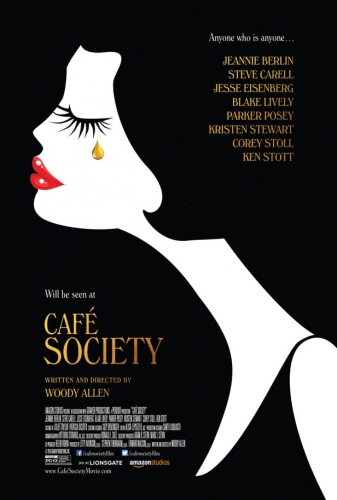Critique - AUSTRALIA de Baz Luhrmann à 20H45 sur Ciné + Emotion

L’histoire se déroule à la fin des années 30. Lady Sarah Ashley, une aristocrate anglaise hautaine, capricieuse et arrogante (Nicole Kidman) -qui ressemble à s’y méprendre à Meryl Streep lorsqu’elle arrive au Kenya dans « Out of Africa »- arrive au cœur des paysages sauvages de l’Australie pour rejoindre son mari qu’elle soupçonne d’adultère, lequel tente, en vain, de vendre l’immense domaine qu’ils possèdent sur place : Faraway Dones. Elle ne tarde pas à découvrir que l’exploitation est au bord de la ruine et menacée par son propre contremaître, Neil Fletcher (David Wenham). Pour sauver le domaine, Sarah n’a d’autre choix que de s’allier à un cow-boy local, plutôt rustre, connu sous le nom de « Drover » (Hugh Jackman), et de parcourir avec lui des milliers de kilomètres à travers les terres aussi magnifiques qu’inhospitalières du pays afin de mener jusqu’à Darwin 1500 têtes de bétail.
L’histoire nous est contée en voix off par un enfant aborigène à travers le regard duquel, enfantin et naïf, nous voyons toute l’histoire mais ce qui marque d’abord ce n’est pas cette voix enfantine, ce sont ces paysages à couper le souffle, ces images flamboyantes, cette photographie majestueuse et ces amples panoramiques et divers mouvements de caméra qui nous embarquent avec eux dans cette Australie rude et somptueuse, inhospitalière et enchanteresse. C’est un fascinant et éblouissant tourbillon pour nos yeux davantage aguerris à un cinéma de plus en plus et essentiellement réaliste.
Le film porte bien son nom : c’est un véritable spot publicitaire pour l’office de tourisme australien sans compter que les deux acteurs principaux et le réalisateur sont, eux aussi, australiens. C’est pourtant au cinéma de l’âge d’or hollywoodien que Baz Luhrmann fait ouvertement référence, notamment à « Autant en emporte le vent » mais aussi à des films plus récents comme « Out of Africa » de Sydney Pollack. Les points communs et les références ne manquent pas : des caractères des personnages (Lady Sarah Ashley ressemble beaucoup, dans ses traits de caractère, à l’impétueuse Scarlett d’ « Autant en emporte le vent » et le viril, sauvage et romantique « Drover » à Rhett Buttler), à l’attachement à la terre, au discours sur l’émancipation de populations opprimées, en passant par les paysages grandioses, les scènes à grand spectacle (l’incendie de Darwin rappelant ainsi celui d’Atlanta), le mélange d’aventure et de drame.
Le projet est donc particulièrement ambitieux et cela fonctionne parfaitement dans la première partie. On se laisse d’abord emporter avec bonheur par cette aventure exotique, rafraichissante, délicieusement naïve, empreinte de magie aborigène. Les personnages sont certes stéréotypés mais Baz Luhrmann, joue de ces stéréotypes (notamment lors d’une scène avec Hugh Jackman au ralenti que je vous laisse découvrir), anticipant et désamorçant les ricanements et les reproches qui pourraient lui être adressés, et gagnant ainsi notre complicité. Ni lui ni nous ne sommes dupes.
Ce film qui voulait s’inscrire dans la lignée des « Lawrence d’Arabie », « Ben Hur » et autres « Titanic » avait donc a priori tout pour me plaire, et c’était d’ailleurs très bien parti, malheureusement il lui manque ce petit supplément d’âme ensorcelant dont l’absence résulte d’abord essentiellement de la facilité avec laquelle le couple de protagonistes franchit les obstacles, à commencer par ceux qui les séparent, et du trop grand nombre d’ellipses (malgré la durée du film). Leurs personnages évoluent, et même changent radicalement, si soudainement que nous avons du mal à y croire et à croire à leur histoire d’amour. Lady Sarah Ashley est aussi capricieuse, arrogante, égoïste, matérialiste, superficielle (rappelant Katharine Hepburn au début d’ « African Queen ») qu’elle devient altruiste, compréhensive, désintéressée et généreuse. Son personnage évolue ( elle est transformée par la beauté dévastatrice des paysages mais aussi par sa rencontre avec le petit orphelin aborigène) et c’est tant mieux mais d’une manière si radicale que nous avons peine à y croire. Sans compter que le méchant est trop méchant pour être crédible mais en même temps…en même temps c’est aussi ce qui contribue au charme de ce film et j’ai alors rappelé à la rescousse mon regard d’enfant, toujours prompte à se rallumer, pour voir ce film différemment : comme un conte de noël. D’ailleurs, il nous parle de magie, de magie aborigène mais aussi du magicien d’Oz (du même Victor Fleming qu’ « Autant en emporte le vent »). D’ailleurs il sort un 24 décembre. D’ailleurs il est tout public. D’ailleurs c’est aussi une leçon de géographie et d’Histoire. D’Histoire parce que nous apprenons beaucoup, d’abord sur la société ségrégationniste de l’Australie des années 30 et 40 qui interdisait les mariages entre blancs et aborigènes et dont les enfants n’avaient le droit de vivre ni parmi les blancs ni parmi leurs familles aborigènes. Ces enfants étaient alors placés dans des institutions d’Etat ou des missions religieuses et furent appelés les Générations Volées. Mais nous apprenons aussi que la ville de Darwin dut faire face aux bombardements japonais. En effet, en février 1942, les avions de guerre japonais, la flotte même qui avait attaqué Pearl Harbour, a attaqué Darwin, tuant 243 personnes et détruisant presque toute la ville.
Alors évidemment, la fin à multiples rebondissements totalement improbables et évidemment heureux (si bien qu’un grand nombre de journalistes a quitté la salle au premier d’entre eux, croyant la projection terminée…ou estimant en avoir assez vu) s’inscrit dans cette lignée de conte qui, certes, avec des regards d’adultes, paraît exagérément mélodramatique et prévisible. C’est sans doute ce qui rend aussi « Autant en emporte le vent », « Out of Africa » ou même « Titanic » crédibles et touchants : leurs fins ouvertes et/ou dramatiques. Mais, après tout, ce ne sont pas des contes de noël…
On peut aussi regretter que Baz Luhrmann n’ait pas fait preuve ici de la même fantaisie et de la même excentricité que celles dont il avait fait preuve dans « Moulin Rouge » qui lui avait valu 8 nominations aux Oscar. Il en avait d’ailleurs remporté deux. Son épouse Catherine Martin avait en effet été oscarisée pour les décors et les costumes dont elle est aussi la créatrice dans « Australia » et pour lesquels elle mérite sans nul doute d’être à nouveau récompensée.
Au final un film flamboyant (au budget, tout de même, de 130 millions de dollars, plus gros budget alloué à un film australien) qui a le mérite d’être particulièrement ambitieux, de mêler les genres (peut-être trop : à la fois comédie au début, film d’aventure, fresque romanesque, drame, western, comédie romantique, conte…), de nous faire découvrir l’Australie dont il exalte brillamment la magnificence et l’immensité vertigineuse des décors, une fresque grandiloquente et excessive, parfois mièvre et sirupeuse aux acteurs, aux paysages et à l’histoire trop beaux, lisses et héroïques pour être vrais ( mais après tout cherche-t-on ici à « être vrai » ?) à voir avec des yeux d’enfants, et avec le recul dont le réalisateur a lui-même su faire preuve.
Un film qui certes n’arrive pas à la hauteur des films auxquels il se réfère, par manque de complexité des personnages et de l’intrigue, mais qui, tout de même, nous fait oublier ses 2H35. Ce qui n’est déjà pas si mal. Et à voir ma voisine de salle (dont j’ignore malheureusement le media, j’aurais été curieuse de lire ou entendre sa critique…) qui, avant que la projection ne débute, disait avec désinvolture ne pas aimer « ce genre de film », a terminé la projection finalement complètement scotché à l’écran, je me dis qu’il n’a pas totalement échoué…
« La seule chose que l’on possède c’est sa propre histoire. Alors vouloir en faire une bonne histoire, désirer avoir une existence bien remplie, vivre une belle aventure, accepter d’affronter la peur pour ne pas tourner le dos aux possibilités que vous offre la vie… ». Ainsi Baz Lurhmann résume-t-il « Australia ». A vous de voir si cette belle aventure vous embarquera « somewhere over the rainbow » ou en tout cas dans les décors majestueux de cette Australie qui donnent indéniablement envie de partir à la découverte de son Outback qu’il amorce et à laquelle il incite magistralement.
Bonus: retrouvez également ma critique de "The great gatsby" de Baz Luhrmann en cliquant ici.